ENS LSH - Colloque - Pour une histoire critique et citoyenne, le cas de l’histoire franco-algérienne
Pour une histoire critique et citoyenne
Le cas de l’histoire franco-algérienne
20, 21, 22 juin 2006
HENNI Ahmed
Université d’Artois
Le système fiscal colonial et la dynamique d’identification communautariste en Algérie entre 1830 et 1918
Mardi 20 juin 2006 - Matin - 9h45-11h45 - Salle F 05
La Première Guerre mondiale marque une rupture dans l’histoire de la configuration sociale algérienne. Des mouvements indépendantistes voient le jour conduits par des « plébéiens »[1]. L’irruption de cette catégorie sur le devant de la scène de l’Histoire indique l’apparition de nouvelles modalités d’intermédiation sociale se traduisant par la « démonétisation » du rôle médiateur des anciennes notabilités traditionnelles et, du même coup, de l’administration coloniale qui les utilise et supposée être, par ailleurs, également médiatrice. Cette recherche de nouveaux médiateurs émergeant du sous-prolétariat musulman se nourrit d’une représentation « communautariste » et d’une culture de défiance vis-à-vis d’une administration coloniale s’écartant des normes universalistes de service public et considérée comme hostile à l’une des communautés - les Algériens - et favorable à l’autre - les Européens.
L’un des éléments décisifs ayant conduit à la production d’une telle représentation est l’ethnicisation de la fiscalité, forme étatique objective de « fracture » communautariste. Le poids des prélèvements fiscaux, dits officiellement et juridiquement « impôts arabes », supportés exclusivement par les Algériens de souche locale, leur usage discriminatoire au bénéfice des colons européens, nous conduit, certes, à une réflexion sur le rôle de l’État colonial comme appareil de transfert des richesses d’une ethnie à une autre mais aussi, tout en s’appuyant sur cette lecture matérialiste, à écarter toute dynamique historique de classe telle qu’a pu laborieusement tenter de l’écrire une histoire militante. La fiscalité coloniale et le rôle joué par les notabilités traditionnelles dans la collecte des impôts arabes ont été à n’en pas douter une cause majeure de l’ethnicisation du mouvement indépendantiste et de l’irruption de la masse des paysans sans terre dans la concrétisation d’une dynamique guevariste avant l’heure et ce malgré l’émergence entre 1918 et 1954 d’un embryon de paysannerie moyenne musulmane[2].
Certes, depuis de nombreux siècles, les pouvoirs successifs en Algérie n’avaient utilisé la fiscalité que pour nourrir leurs propres dépenses, militaires notamment, n’assurant pratiquement aucun retour aux populations. C’est ainsi que le régime des janissaires (1518-1830) avait poussé à l’extrême cette pratique, faisant de la fiscalité un moyen d’extorsion sans retour et ne laissant à sa disparition pratiquement aucune infrastructure ou administration de service public. Dans le même temps, le dey (le chef des janissaires) constituait un trésor personnel évalué à 7 212 kilogrammes d’or et 108 704 kilogrammes d’argent[3].
Lorsque le gouvernement français décide en 1830 d’occuper l’Algérie, il semble qu’il n’ait encore aucune idée précise du mode de gestion à appliquer à cette nouvelle colonie. Dès lors, le plus simple fut de reproduire le système fiscal des janissaires. Cette politique d’attentisme et d’hésitation allait produire les mêmes effets que sous la Régence des janissaires : intégration de notabilités chargées de collecter l’impôt mais exclusion d’une paysannerie qui, outre les spoliations foncières qu’elle pouvait subir, continua d’être imposée, pratiquement sans retour, sur son capital au lieu de l’être sur son revenu. Les colons européens en étant exonérés, la fiscalité fut ainsi une mécanique de paupérisation dirigée contre une population particulière. Dès lors, elle apparut comme un système d’impôts « ethniques » faisant obstacle à l’adoption de toute culture « civile », aussi bien parmi les colons que parmi les Algériens. Elle empêchait toute solidarité universaliste ou de classes entre Algériens et colons et, à n’en pas douter, démonétisait aussi bien les attitudes « civiles » intégrationnistes que socialistes.
La reproduction du système fiscal des janissaires
Les troupes françaises ont débarqué à Alger le 14 juin 1830. Le 5 juillet la capitulation du dey est obtenue et, de fait, une administration coloniale commence à se substituer au gouvernement des janissaires même si la conquête du territoire durera plus de quinze ans. Dès lors, le système de prélèvement fiscal colonial touchera d’abord la capitale, et donc ses marchands et artisans, puis, par l’annexion des campagnes alentour, la paysannerie. Cette évolution est corollaire des succès militaires sur le terrain et ne procède d’aucune élaboration a priori d’un système. C’est au fur à mesure de la conquête que les rentrées fiscales progressent. Leur augmentation ne traduit pas une meilleure productivité d’un nouveau système. Les recettes sont de 1 687 000 francs[4] en 1835, restent encore à 4 748 000 francs en 1844 et, la majeure partie du territoire étant conquise, « sautent », dès 1846, à près de 14 000 000 francs. Ces recettes sont minimes au regard des dépenses militaires déboursées par le budget parisien - un total de 48 500 000 francs de 1830 à 1845.
La fiscalité, cependant, à cette époque, rapporte moins au patrimoine de l’État ou à son budget que les diverses confiscations engendrées par la guerre de conquête - le seul « trésor » du dey confisqué en 1830 et comptabilisé par le budget parisien s’élève à 48 685 000 francs. Dès lors, la fiscalité à destination de la population locale se présente plus comme un moyen de contrôle et de répression que comme source d’un budget rationalisé. Dès 1831, on compte 440 000 francs de produits du domaine pour seulement 452 000 francs de recettes fiscales[5].
Le 27 janvier 1831, la patente est imposée aux commerçants et artisans. Le 30 juillet, un tarif douanier entre en vigueur. Le 7 septembre, une taxe d’abattage est instituée[6]. Ces mesures restent propres aux villes, la capitale notamment. Ce n’est qu’avec la chute du beylik de Constantine (1839) et l’annexion de cette province que les impôts sur la production agricole commencent à être sérieusement prélevés. Ces impôts, dits « arabes », sont dès 1842 introduits dans les provinces d’Alger et d’Oran. En 1843, les impôts arabes, exclusivement assis sur la paysannerie locale musulmane, représentent déjà 50 % des rentrées fiscales. Ils sont finalement officialisés par les ordonnances du 15 avril 1845 et du 2 janvier 1846[7]. À partir de 1850, ces impôts sont exigés en « argent ». Cette mesure fait entrer dans la circulation « quantités d’espèces que les tribus thésaurisaient »[8]. Martial Douël pense que la mesure n’est pas tant destinée à intégrer la paysannerie dans l’économie monétaire qu’à lui ôter son épargne-argent pour éviter toute acquisition ultérieure d’armes et de poudre, autre indice d’une fiscalité plus politique qu’économique.
C’est ainsi que, pour faciliter l’implantation de villages de colonisation sur les terres récemment soustraites à la paysannerie, l’ordonnance du 17 janvier 1845 attribue aux collectivités locales 10 % du montant total des impôts arabes. Or, seules les « communes » habitées par des colons sont considérées comme collectivités locales, le reste du territoire étant soumis à administration militaire. Le décret impérial du 25 août 1852 porte cette part à 30 %. Les mesures budgétaires de 1859 la relèvent à 40 % à compter du 1er janvier. Enfin, à partir de septembre 1861, elle est portée à 50 %. Les besoins des villages coloniaux s’accroissant, cette part monte jusqu’à 60 % en 1868 pour revenir à 50 % à partir de 1873. Ces ressources étant insuffisantes, on attribue également aux communes de plein exercice, c’est-à-dire habitées par des colons, la quasi-totalité des redevances perçues au titre de l’octroi de mer (5/6e) ou des taxes sur les marchés, l’abattage ou les chiens.
Cette dynamique de prélèvement sur la paysannerie locale, pour financer, sur ses propres terres, l’implantation coloniale, s’écarte du principe de l’universalité budgétaire et, par l’affectation d’une ressource particulière à un emploi particulier, semble entraîner plusieurs conséquences :
- une aggravation de la pression fiscale sur la paysannerie chaque fois que les besoins des « villages coloniaux » l’exigent ;
- un effet d’annonce auprès de l’opinion publique parisienne par l’exonération du contribuable métropolitain de tout financement des charges de colonisation ;
- une dualité locale en Algérie où l’activité qui finance la colonisation locale se paupérise alors que l’implantation coloniale fleurit, aggravant ainsi les contrastes de proximité et engendrant un rythme différencié de développement communautaire séparé.
C’est ainsi que pour accroître les recettes fiscales des communes de plein exercice, un arrêté pris par le gouverneur général Randon institue le 30 juillet 1855 des « centimes additionnels » venant se surajouter au principal des « impôts arabes » dus par la paysannerie locale. Sur un total de 21 centimes pouvant être perçus annuellement, on prévoit d’en réserver 10 aux besoins des collectivités locales et 8 pour l’assistance hospitalière. La rallonge pour les besoins locaux, c’est-à-dire pour les colons, est portée à 18 centimes en 1858 puis ramenée à 12 centimes en 1897. Il est vrai que la liste des « centimes additionnels » s’était entre-temps enrichie en 1873 d’une nouvelle redevance : le 26 juillet 1873, des « centimes additionnels extraordinaires » sont institués pour couvrir les frais de délimitation de la propriété engendrés par l’application de la loi foncière, dite loi Warnier - trois centimes universels, vingt centimes en pays de lezma et quatre centimes en pays d’achour.
Les impôts arabes
Ils sont le fruit de l’opportunité. Agissant dans le feu de l’action militaire de conquête, les autorités coloniales se contentent de reproduire le système fiscal existant sous les janissaires. Celui-ci reposait principalement sur quatre impôts agricoles : l’achour, le hokor, la lezma et la zekat. Les taux sont ceux-là mêmes fixés par le beylik.
L’achour et le hokor sont assis sur les terres cultivées par la paysannerie locale - les colons en sont exonérés, comme ils sont exonérés, jusqu’en 1918, de pratiquement toute imposition directe. L’achour concerne les terres que l’autorité considère en propriété ou usufruit privatifs, l’hokor les terres considérées comme de souveraineté publique et « concédées » en usufruit aux musulmans. La lezma est un impôt de capitation sur les personnes musulmanes et la zekat un impôt de capitation sur le bétail - celui qui appartient aux seuls musulmans[9]. À l’Est (beylik de Constantine), l’achour et le hokor sont assis sur le nombre d’instruments aratoires possédés tandis qu’au Centre et à l’Ouest (Alger et Oran), ils sont assis sur la surface pouvant être cultivée par un instrument aratoire (10 hectares environ). Dans les deux cas on parlera de « charrue ». Bref, ils ne sont pas assis sur le flux de production annuel mais sur la surface, c’est-à-dire le capital et ne tiennent pas compte du rendement. La météorologie capricieuse les rend particulièrement antiéconomiques aggravant la pauvreté des années de sécheresse. En 1845, le taux est de 15 francs par charrue pour l’achour et de 25 francs pour l’hokor - soit un quintal et un quintal et demi de blé. À partir de 1858, l’achour passe à 25 francs et l’hokor à 30 francs par charrue, le prix du blé n’ayant pas bougé entre-temps.
Le fermier colon d’un propriétaire algérien est exonéré de l’achour. Le fermier algérien d’un propriétaire colon est redevable de l’achour (Avis du Conseil de gouvernement du 5 mars 1849). Une décision du 25 août 1859 reviendra sur cette pratique. Les Algériens fermiers de colons seront exonérés de l’achour. Cependant, un arrêté de 1872 pris par le vice-amiral Gueydon, gouverneur général, annulera cette décision et reviendra à la pratique de 1849.
La catastrophe météorologique de 1867 provoquant une famine sans précédent et une accélération de la « clochardisation » de la paysannerie locale contraint à réaménager le système fiscal et à y introduire des classes de revenus. À compter de 1874, cinq classes de contribuables sont instituées en fonction de la fertilité théorique de leurs terres. Le système reste assis sur le capital mais introduit une différencialité des rendements :
Tableau 1 - Classes d’imposition sur l’activité agricole des fellahs[10]
| Fertilité de la terre | Achour dû |
| Récolte très bonne | 88 F par charrue (4,5 quintaux de blé pour 10 ha) |
| Récolte bonne | 66 F par charrue |
| Récolte assez bonne | 44 F par charrue |
| Récolte mauvaise | 22 F par charrue |
| Récolte nulle | 0 F par charrue |
Assis sur les surfaces et le rendement théorique, ce type de prélèvement a plusieurs conséquences :
- S’il pénalise la pauvreté, il peut favoriser la culture extensive des grands propriétaires. Quand un paysan titulaire d’une charrue (10 hectares) ne peut, par obligation de jachère annuelle, cultiver que 5 hectares, récolter 25 quintaux théoriques en blé et supporter un prélèvement de 2,5 quintaux ce qui lui laisse 22,5 quintaux pour cinq personnes, une bête de somme et la semence, soit le minimum vital (3 quintaux par tête), un grand propriétaire paie pour 100 hectares 25 quintaux et il lui reste 225 quintaux. L’achour, s’il est une prime au retard technique, préserve la condition des notables et reste un élément majeur de la reproduction en l’état des hiérarchies sociales, des structures de commandement traditionnelles et d’une alliance d’intérêt objective entre les notabilités et l’appareil colonial.
- La différenciation des terres ne s’appuie pas sur un système déclaratif individuel mais sur une évaluation des rendements opérée précisément par ces notabilités ou par le commandement colonial. Outre qu’elle introduit des possibilités indues de dégrèvement pour ceux qui ont de l’entregent, elle renforce le clientélisme des paysans vis-à-vis des « caïds »[11] évaluateurs officiels et le clientélisme de ces caïds vis-à-vis du commandement colonial.
Les recensements opérés par l’administration révèlent aussi bien une situation objectivement mauvaise de la paysannerie qu’une possible surévaluation des mauvaises charrues par les caïds et le commandement afin de « rendre service » à leurs clients. Nous avons un exemple dans le sondage suivant opéré dans les départements d’Alger et d’Oran par la Commission d’enquête de 1892 :
Tableau 2 - Distribution de la fertilité agricole dans les surfaces cultivées par les fellahs en 1892
| Fertilité des terres | Surface imposée | |
| Alger | Oran | |
| Très bonnes charrues | 410 ha | 7 020 ha |
| Bonnes charrues | 3 850 ha | 80 120 ha |
| Assez bonnes charrues | 136 330 ha | 161 770 ha |
| Mauvaises charrues | 177 770 ha | 114 520 ha |
| Charrues nulles | 70 140 ha | 16 430 ha |
Source : Commission d’enquête de 1892 sur l’impôt arabe, Sénateur Clamageran, Rapport sur le régime fiscal en Algérie, Paris : Imprimerie Mouillot, 1892.
Figure 1 - Région Ouest (Oran)
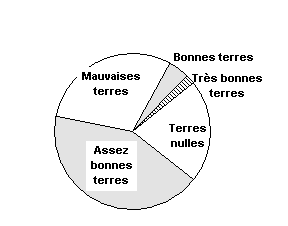
Figure 2 - Région Centre (Alger)
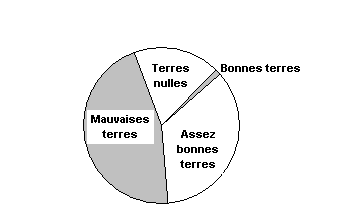
L’absence de règles fiscales élémentaires (universalité, déclaration, contrôle) provoque aussi bien un communautarisme objectif qu’une dynamique économique séparée ou un mode de gestion social et politique distinct par communauté. Elle entrave à n’en pas douter tout devenir individuel aussi bien chez les colons que chez les Algériens. Le sénateur Rouire observe en 1908 que si les 2 500 000 hectares cultivés par les « Arabes » rapportent 17 millions au Trésor public, les 994 000 hectares cultivés par les colons lui rapportent 0 francs[12]. Bref, la fiscalité contredisait toute apparition d’une culture civile et civique dans les deux « communautés ». Elle pouvait même développer le sentiment d’une appartenance « identitaire » fondée, des deux côtés, sur le seul communautarisme.
Aux impôts sur l’activité agricole et pastorale qui frappent la seule « communauté » algérienne, viennent progressivement se superposer d’autres redevances assises exclusivement sur elle et, souvent, inspirées de l’ancien régime janissaire:
1) L’impôt de capitation par « feu » (tente, habitation) ou par tête (lezma). Dès 1858, la lezma est assise sur le revenu estimé. On institue trois classes de redevables : 15 francs, 10 francs et 5 francs par tête, soit, aux taux le plus bas, l’équivalent de 1,5 quintal de blé pour un foyer de cinq personnes. L’arrêté du 9 septembre 1886 crée cinq classes de contribuables : 100 francs, 50 francs, 15 francs, 10 francs et 5 francs. En 1894, une sixième classe à 30 francs est ajoutée. Les rôles de la lezma permettent de se faire une idée de la hiérarchie des revenus et de l’importance des différentes catégories sociales rurales. Voici une statistique de 1890 pour la région Centre :
Tableau 3 - Classes de revenus chez les fellahs de la région Centre (1890)
| Classe de revenu | Nombre de contribuables |
| Plus de 2 400 F (plus de 130 q de blé environ) | 211 |
| de 1 600 à 2 400 F (entre 90 et 130 q) | 1 092 |
| de 900 à 1 600 F (entre 50 et 90 q) | 2 127 |
| de 400 à 900 F (entre 22 et 50 q) | 21 003 |
| de 200 à 400 F (entre 12 et 22 q) | 20 399 |
| moins de 200 F (moins de 12 q) | 30 156 |
Figure 3 - Importance des différentes classes de contribuables en fonction de leur revenu
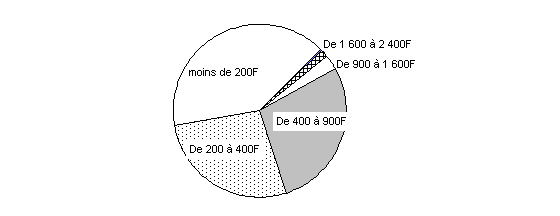
On observe que la majorité de la population dispose de moins de 400 francs par an, soit moins de 22 quintaux de blé, c’est-à-dire pour cinq personnes et un kilo de blé par jour et par personne, le minimum de subsistance.
2) Les prestations en nature en faveur des communes : corvées de type féodal consistant en trois journées de travail gratuites par an au bénéfice de l’Administration. En sont frappés l’homme algérien, le cheval, le mulet, l’âne et le bœuf appartenant à des Algériens. La « corvée » peut être rachetée en argent : 2 francs par journée « humaine », 2 francs pour le cheval et le mulet, 1,50 francs pour le bœuf et 0,50 francs pour l’âne. En favorisant les riches qui peuvent racheter leur corvée et en éviter l’humiliation, le système, s’il renforce l’alliance d’intérêt objective entre notabilités et commandement, engendre un aiguisement du sentiment d’appartenance communautaire attaché au statut social du groupe soumis (fellahs) ou exonéré de corvée (colons). À cette corvée, s’ajoutent une quatrième journée pour l’entretien des chemins ruraux et les réquisitions périodiques pour la surveillance des forêts et l’extinction des incendies. Outre l’humiliation identitaire, la corvée est un travail gratuit effectué pour le seul bénéfice de la colonisation. Les fellahs qui y sont soumis n’en tirent aucun avantage pour eux-mêmes ou leur « communauté ».
3) La diffa, repas obligatoirement offert par les populations algériennes aux agents de l’administration coloniale en tournée.
4) L’octroi de mer et les droits de douanes. Les collectivités locales, c’est-a-dire villages de colons, reçoivent ainsi de 1870 à 1900 un total de 246 millions de droits d’octroi et de douanes s’ajoutant à leur part des recettes en impôts arabes qui s’élève à 206 millions au total sur ces trente années[13]. L’octroi de mer est réparti depuis le 13 janvier 1845 à raison de 10 % pour le Trésor et 90 % pour les municipalités - de plein exercice. Il est réglé en bloc par les importateurs de produits de consommation courante (sucre, café, thé, poivre, bougies, etc.). En raison de leur nombre, les Algériens en acquittent la plus grande part. Si, en 1845, il est prévu de prélever 5 francs par quintal de sucre et seulement 3 francs par quintal de fromage - destiné principalement aux colons -, en 1930, le kilo de sel supporte 0,63 francs alors que le litre de vin - que ne boivent pas les musulmans - n’acquitte que 0,32 francs.
5) À ces prélèvements réguliers, s’ajoutent jusqu’en 1900, des contributions exceptionnelles infligées pour faits de guerre aux tribus insurgées : 58 millions de francs au total entre 1830 et 1865 et 35 millions entre 1870 et 1900.
Les amendes, perçues particulièrement au titre des infractions au code des forêts - pacage non autorisé -, ont, quant à elles, rapporté, jusqu’en 1900, un total de 18,5 millions de francs.
Vers la fin du siècle, les autorités elles-mêmes commencent à s’émouvoir de l’importance des charges fiscales supportées par la paysannerie locale. Le gouverneur général Jonnart déclare en 1892 que « certains impôts excèdent les facultés contributives des indigènes et atteignent le principe même du développement agricole »[14]. Charles-Robert Ageron cite une étude de l’administration qui conclut que le fellah moyen supporte 50 francs d’impôt pour un revenu de 350 francs[15]. En 1912, le professeur parisien Oualid, au terme d’une étude sur La fortune mobilière en Algérie, conclut que les Algériens paient 71 % des impôts directs alors qu’ils ne possèdent que 38 % du patrimoine immobilier et foncier[16].
La controverse périodique qui, au tournant du siècle, se nourrit d’enquêtes, d’évaluations, de contre-évaluations éclaire les hésitations de l’Administration qui, une fois le territoire entièrement conquis, n’a plus besoin d’appauvrir de potentiels insurgés mais aurait plutôt besoin de personnes se prenant en charge et n’émargeant pas à une assistance budgétaire. Le gouverneur Jonnart parle bien de « développement agricole ». La loi du 14 avril 1893 crée même des Sociétés indigènes de prévoyance (SIP) chargées de prêter semences et argent aux fellahs en difficulté. Il faudra attendre cependant la fin de la Première Guerre mondiale pour qu’une refonte totale du système fiscal intervienne (1918), rompant avec le communautarisme et instituant des impôts universels.
La dynamique communautariste des dépenses budgétaires
En imposant différemment colons et fellahs, le système fiscal nourrit une différenciation communautariste que va aiguiser l’usage même des recettes fiscales. Sur un plan purement comptable, on peut avancer sans hésitation le fait que ce sont les fellahs qui ont financé les dépenses de colonisation agricole faite à leurs dépens. Le total de ces dépenses s’élève jusqu’en 1900 à 173 millions de francs. Or, les seules « contributions de guerre » et « amendes » ont, durant la même période, rapporté 111,5 millions. À ceci s’ajoutent les contributions fiscales ordinaires et régulières directes et indirectes qui, entre 1830 et 1900, rapportent, bon an mal an, 25 millions en moyenne. Si, entre 1830 et 1896, il est difficile d’évaluer le retour de ces impôts à leurs payeurs et de mesurer le degré d’institution d’une culture de service public, il est par contre aisé, après la suppression des rattachements au budget parisien, de suivre dans les années 1900 le détail des flux de recettes et de dépenses par destination.
L’échantillon que nous allons analyser porte sur les années 1901-1905. Pour supprimer les biais pouvant être introduits par les variations annuelles, nous allons considérer la moyenne annuelle quinquennale des recettes et dépenses.
Tableau 4 - Moyenne annuelle des recettes budgétaires d’État et des collectivités locales (1901-1905)
| Moyenne annuelle (milliers de F) | En % du total | |
| Impôts d’État | ||
| Impôts arabes et centimes additionnels | 8 529 | 20,50 |
| Droits de douane | 13 867 | 33,33 |
| Droits de mutation et enregistrement | 4 815 | 11,57 |
| Tabac, boissons, alcools | 7 393 | 17,77 |
| Impôt foncier sur le bâti | 2 073 | 4,98 |
| Patentes | 2 036 | 4,89 |
| Octroi de mer (part de l’État 1/6e) | 1 923 | 4,62 |
| Amendes | 704 | 1,69 |
| Taxe sur le revenu | 203 | 0,49 |
| Taxe sur les mines | 63 | 0,15 |
| Total | 41 610 | 100 |
| Recettes départementales | ||
| Impôts arabes | 995 | 65,59 |
| Centimes ordinaires | 225 | 14,86 |
| Centimes extraordinaires | 198 | 13,08 |
| Taxe sur la vigne | 98 | 6,47 |
| Total | 1 517 | 100 |
| Recettes communales | ||
| Centimes sur les impôts arabes | 265 | 3,48 |
| Autres centimes | 289 | 3,80 |
| Amendes | 40 | 0,53 |
| Taxes locatives | 454 | 5,96 |
| Taxe de balayage | 100 | 1,32 |
| Taxe sur les chiens | 56 | 0,74 |
| Prestations (rachat des corvées) | 1 945 | 25,54 |
| Droits de place et d’abattage | 1 821 | 23,92 |
| Octroi de mer | 1 350 | 17,73 |
| Revenu des propriétés communales | 832 | 10,93 |
| Actes administratifs | 461 | 6,05 |
| Total | 7 616 | 100 |
| Total général | 50 743 |
La ventilation des recettes centrales ou locales montre que l’activité principale de la colonie - la vini-viticulture - n’est pas directement imposée ni sur le foncier (non bâti) ni sur le revenu. Il en est de même des activités minières. L’essentiel des recettes provient soit des impôts directs sur les fellahs - noter le montant élevé des rachats de corvées - soit indirectement de la consommation qui, lorsqu’il s’agit de produits courants comme le tabac, les cafés, huiles et sucres, dépend, elle, de la démographie. Cette communautarisation pourrait ne pas avoir de conséquences discriminantes si les dépenses devaient bénéficier aux « payeurs ». Or, c’est l’inverse qui se produit comme le montrent les données suivantes.
Tableau 5 - Moyenne annuelle des dépenses d’État (1901-1905)
Dépenses budgétaires centrales |
Moyenne annuelle (1 000 F) |
En % du total | Observations |
| Dette publique | 990 | 2,02 | Service des emprunts destinés à valoriser la colonie |
| Administration (gouvernement général) | 1 358 | 2,77 | Paye de fonctionnaires dont la quasi totalité est d’origine européenne |
| Administration des départements et communes | 2 396 | 4,89 | ibid. |
| Administration du Trésor | 516 | 1,05 | ibid. |
| Sûreté et gendarmerie | 3 086 | 6,29 | ibid. |
| Prisons | 1 937 | 3,95 | ibid. |
| Douanes | 1 626 | 3,32 | ibid. |
| Impôts | 3 348 | 6,83 | ibid. |
| Enregistrement et domaines | 1 179 | 2,40 | ibid. |
| Colonisation | 1 885 | 3,84 | ibid. |
| Postes, télégraphe, téléphone | 6 962 | 14,20 | ibid. |
| Administration militaire | 467 | 0,95 | Les dépenses militaires sont assurées par Paris |
| Travaux publics, mines, chemins de fer | 13 648 | 27,83 | Infrastructures valorisant les activités coloniales |
| Agriculture | 1 525 | 3,11 | ibid. |
| Eaux et forêts | 3 074 | 6,27 | ibid. |
| Topographie | 434 | 0,89 | ibid. |
| Emploi des fonds d’emprunt | 4 598 | 9,38 | ibid. |
| Total | 49 033 | 100 |
Outre le paiement de fonctionnaires qui dans leur quasi totalité ne sont pas des enfants de fellahs, on observe ici que les dépenses ont deux destinations principales : assurer la réalisation d’infrastructures permettant aux activités coloniales de se valoriser (communications, ports, hydraulique) et financer la sécurité (sûreté, gendarmerie, prisons). Entrer plus finement dans le détail permet de mettre mieux en évidence la destination par « communauté ».
Tableau 6 - Dépenses moyennes annuelles par « communauté » (milliers de francs)
| Nature des dépenses | Montant alloué aux indigènes | En % du total | Montant alloué aux colons | En % du total | Total |
| Culte | 389 | 29,15 | 947 | 70,85 | 1 336 |
| Instruction publique | 1 231 | 18,12 | 5 563 | 81,88 | 6 794 |
| Justice musulmane | 100 | 100 | |||
| Justice française | 2 449 | ||||
| Assistance publique | 254 | 9,20 | 2 503 | 90,80 | 2 757 |
Les postes « assistance publique » et « instruction publique » semblent les plus significatifs en matière de culture de « service public » universel. Entre 1901 et 1905, il faut compter en moyenne 4 000 000 d’Algériens et 650 000 colons, soit, pour l’instruction publique par exemple, une dépense budgétaire centrale de 0,30 francs par Algérien et 8,55 francs par Européen. La disproportion observée se poursuivra jusqu’en 1954 comme le montrent les données prélevées par sondage sur deux autres années :
Tableau 7
| Dépenses en milliers de francs | ||||
| 1926 | 1930 | |||
| Indigènes | Colons | Indigènes | Colons | |
| Assistance publique | 890 | 14 000 | 2 400 | 46 000 |
| Instruction publique | 15 000 | 55 000 | 34 000 | 144 000 |
L’analyse des dépenses communales confirme et traduit même, au niveau local, une aggravation de la disproportion entre les communautés bénéficiaires.
Tableau 8 - Dépenses communales pour l’année 1905 (milliers de francs)
| Nature | Montant | En % du total |
| Administration générale | 3 457 | 9,08 |
| Frais de gestion | 965 | 2,53 |
| Dette | 4 454 | 11,70 |
| Police | 3 346 | 8,79 |
| Éclairage | 1 199 | 3,15 |
| Eaux | 2 256 | 5,93 |
| Dispensaires | 173 | 0,45 |
| Hygiène | 130 | 0,34 |
| Assistance pour les colons | 450 | 1,18 |
| Assistance pour les Algériens | 439 | 1,15 |
| Instruction publique | 3 817 | 10,03 |
| Beaux-arts | 546 | 1,43 |
| Biens communaux | 2 904 | 7,63 |
| Voirie, travaux publics | 13 734 | 36,08 |
| Fêtes publiques | 198 | 0,52 |
| Total | 38 068 | 100 |
Conclusion
L’analyse de la fiscalité et de la politique budgétaire coloniale en matière de dépenses fait ressortir qu’entre 1830 et 1918 un principe de communautarisation a été mis en place en Algérie, installant pour une longue période une pratique d’administration séparée sur des bases ethniques. La « communauté indigène », composée essentiellement d’agro-pasteurs, si elle a été la première à contribuer aux finances publiques, a été la dernière servie. L’autorité publique a institutionnalisé un système utilisant la médiation du politique pour transférer collectivement des ressources d’une communauté à l’autre. Si un tel système a permis de maintenir en place les notabilités de commandement locales en leur attribuant des fonctions de collecte de l’impôt, reproduisant en cela certains traits historiques antérieurs à la colonisation, il a, en même temps, faute de retour sous forme de service public de leurs recettes aux payeurs, fait apparaître ces notabilités - et l’Administration - comme des éléments purement répressifs. Dès lors, on peut y voir l’une des raisons du détournement des populations algériennes de leurs propres notabilités ainsi démonétisées. Elles chercheront, de ce fait, le chemin de leur émancipation sous la conduite d’autres médiateurs, principalement issus du sous-prolétariat qui sauront combiner l’opposition ethnique aux colons, l’opposition politique à l’administration et l’opposition sociale aux notabilités musulmanes. À ce résultat s’en ajoute un autre : après une si longue tradition, l’administration algérienne ne pourra pas avant longtemps apparaître comme une instance de médiation ou de service public. Elle donnera toujours l’image, jusqu’à nos jours, d’un fondé de pouvoir gérant privativement l’État au bénéfice de « rentiers » et au détriment des véritables « payeurs ».
Sources[17]
Sources
Ministère de la Guerre, Tableaux de la situation des établissements français du Nord de l’Afrique, Paris, 1840-1866.
Gouvernement général, Exposé de la situation générale, Alger, 1875 à 1960.
Gouvernement général, Étude sur les impôts arabes en Algérie, 1879.
Gouvernement général, Commission d’études des charges fiscales, Rapport Bouvagnet, 1898.
Gouvernement général, Notice sur les impôts arabes, 1899.
Rapport du président de la Commission des impôts arabes à M. le Gouverneur général, Rapport Beaucoudray, 1902.
Comptes rendus des délibérations du Conseil supérieur de gouvernement, 1881-1897.
Comptes rendus des délibérations des Délégations financières, 1907-1918.
Statistique financière, 1905-1911 et 1937.
Rapport sur le budget, 1875, 1908-1910, 1935.
Bibliographie
Ageron C.-R. Les Algériens musulmans et la France. Paris : PUF, 1968, 2 vol.
Bazille C. Les indigènes algériens et l’impôt arabe. Paris : Levrault, 1882.
Bernard P. Les anciens impôts de l’Afrique du Nord. Paris : Éditions des Tablettes, 1925.
Blondelle A. L’octroi de mer en Algérie. Paris : Larose, 1913.
Bonzom L. Du régime fiscal en Algérie. Paris : Rousseau, 1889.
Chauvin E. La justice fiscale en Algérie. Alger : Fontana, 1913.
Clamageran (Sénateur). Rapport sur le régime fiscal en Algérie. Paris : Imprimerie Mouillot, 1892.
Cochery A. Rapport sur budget de 1871. Paris : Assemblée nationale, 1871.
Cochut A. « L’Algérie et le budget ». Revue des Deux Mondes, mars 1849.
Coste H. Les impôts « achour » et « hokor » dans le département de Constantine. Thèse, Université d’Alger, 1911.
Doumergue (Sénateur). Rapport sur le budget de l’Algérie. Paris : Sénat, 1913.
Douël M. Un siècle de finances coloniales. Paris : Plon, 1930.
Dupuy H. Les impôts indigènes en Algérie. Thèse, Université de Montpellier, 1910.
Nouschi A. Enquête sur le niveau de vie des populations constantinoises de la conquête jusqu’en 1919. Paris : PUF, 1961.
Troussel M. Les impôts arabes en Algérie. Thèse, Université d’Alger, 1922.
[1] Terminologie utilisée par Mohamed Harbi, Le FLN, mirages et réalités. Paris : Jeune Afrique, 1978. Voir sur l’« ancêtre fondateur » de l’indépendantisme algérien : Omar Carlier, « Culture politique et mémoire militante : l’Étoile nord-africaine et la figure de l’ancêtre fondateur ». Hespéris tamuda, 1993, n° 31 ; et d’une manière générale sur la naissance du nationalisme « communautariste » André Nouschi, La naissance du nationalisme algérien 1914-1954. Paris : Minuit, 1962 ; Charles-Robert Ageron, Histoire de l’Algérie contemporaine. Paris : PUF, 1964 ; René Galissot, Maghreb-Algérie, classes et nation. Paris : Arcantère, 1988 ; Gilbert Meynier, Histoire intérieure du FLN, 1954-1962. Paris : Fayard, 2002.
[2] Pour des développements détaillés sur l’émergence quantitative du sous-prolétariat musulman et de la paysannerie musulmane moyenne, se reporter à notre article « La naissance d’une classe moyenne paysanne musulmane après la Première Guerre mondiale ». Revue française d’histoire d’outre-mer, juin 1996, t. 83, n° 311, p. 47-63.
[3] Voir notamment Marcel Emerit, Une cause de l’expédition d’Alger : le Trésor de la Casbah. Paris, 1955.
[4] Multiplier par trois si l’on veut trouver un équivalent euro approchant.
[5] Quand leur source n’est pas indiquée, les données sont tirées de documents du Gouvernement général de l’Algérie ou des différents rapports sur le budget commis par des élus (Assemblée, Sénat). Parmi les différentes sources qui nous ont permis de reconstituer certaines séries, citons particulièrement les collections du : ministère de la Guerre, Tableaux de la situation des établissements français du Nord de l’Afrique, Paris, 1840-1866 ; Gouvernement général, Exposé de la situation générale, Alger, annuel de 1875 à 1960 ; Gouvernement général, Étude sur les impôts arabes en Algérie, 1879 ; Gouvernement général, Commission d’études des charges fiscales, Rapport Bouvagnet, 1898 ; Gouvernement général, Notice sur les impôts arabes, 1899 ; Rapport du président de la Commission des impôts arabes à M. le Gouverneur général, Rapport Beaucoudray, 1902 ; Comptes rendus des délibérations du Conseil supérieur de gouvernement, 1881-1897 ; Comptes rendus des délibérations des Délégations financières, 1907-1918 ; Statistique financière, 1905-1911 et 1937 ; Rapport sur le budget, 1875, 1908-1910, 1935.
[6] L’institution de la patente dès ce moment permet aujourd’hui de mesurer l’importance en nombre des marchands et artisans algériens existant dans les années 1830 à Alger, soit 1 264 patentables. Ce chiffre indique une atrophie complète de cette couche sociale moyenne et médiatrice, ruinée et décimée par le monopole du commerce extérieur imposé par les janissaires.
[7] Ordonnances royales de Louis-Philippe. La colonie n’ayant pas, jusqu’en 1897, de budget propre, toutes les mesures fiscales sont arrêtées par Paris. La loi de finances de 1845 avait institué des « rattachements budgétaires », décidant qu’à partir de 1846 toutes les dépenses et recettes d’Algérie seraient rattachées au budget de l’État français. Ce « rattachement » est supprimé en 1896. Dès lors, il s’avère très difficile de connaître entre 1830 et 1896 la ventilation exacte des recettes et dépenses en Algérie, celles-ci n’apparaissant souvent que dans une seule ligne dans le budget parisien ; et les décrets du 26 août 1881 font éclater ces recettes entre les divers ministères parisiens de telle sorte que la fiscalité en Algérie en devient un dédale ténébreux.
[8] Martial Douël, Un siècle de finances coloniales. Paris : Librairie Félix Alcan, 1930.
[9] Sur l’exposé détaillé de la nature et des taux de ces impôts voir Charles-Robert Ageron, Les Algériens musulmans et la France. Paris : PUF, 1968, 2 vol.
[10] « Fellah » : paysan local ; terminologie plus commode qu’une autre pour distinguer les agriculteurs locaux des colons immigrés mais terminologie imprécise puisqu’elle confond paysans et ruraux sans terre.
[11] « Caïd » : chef traditionnel local.
[12] Rouire, « La propriété foncière en Algérie ». Revue des Deux Mondes, 1900.
[13] Soit pour les villages coloniaux un équivalent de 1,350 milliard d’euros. Nul besoin de chercher ailleurs les raisons de leur bonne tenue et coquetterie civilisée.
[14] Exposé de la situation générale, 1892.
[15] C.-R. Ageron, op. cit., t. II, p. 729.
[16] William Oualid, La fortune mobilière en Algérie. Paris : Sirey, 1912.
[17] Documents disponibles à la Bibliothèque nationale et, pour les commissions parlementaires, à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Ahmed Henni, « Le système fiscal colonial et la dynamique d’identification communautariste en Algérie entre 1830 et 1918 », colloque Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne, 20-22 juin 2006, Lyon, ENS LSH, 2007,
http://ens-web3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=281